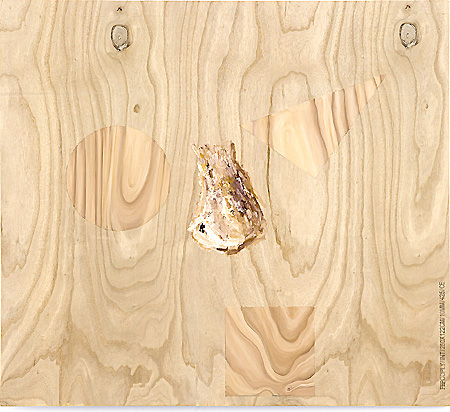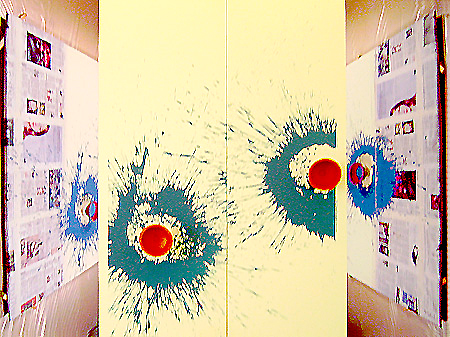| |
Dominique Figarella est engagé dans une exigeante
pratique de la peinture, férocement contemporaine,
savante et néanmoins accessible. Une généreuse
intelligence au service d'une libre perception.
Dans ses pièces les plus récentes, il introduit des
photographies. Le tableau, photographié en cours
d’élaboration, accueille sur sa surface cette même
photographie, appliquée, déformée, qui vient souligner
les processus de construction. Un jeu complexe de
décisions et d’accidents, de gestes et
d’empreintes s’y met en scène tandis que la
peinture, conçue dans une démarche résolument
abstraite, travaille à figurer l’acte même de
peindre. La mise en tableau de cette image
cristallise la Création, sublimant la temporalité de
composition de la forme peinte. Dans d’autres
pièces, il fait entrer le langage via d’historiques
énoncés conceptuels. Au spectateur de travailler
: les œuvres de Figarella nous placent sans cesse
face à des interrogations et nous conduisent toujours
plus loin pour, paradoxalement, mieux nous rapprocher de
sa pratique et de la Peinture.
 
« […] Il se trouve des sensations pour lesquelles
on ne puisse pas trancher au plus tôt dans le processus
de perception, pour savoir si l’on a affaire à une
sensation relative à l’objet que l’on voit, ou
si cette sensation est l’effet d’un
déplacement, d’un écart opéré dans les
conventions de perceptions. »
« […] dans l’exercice d’une pratique
(quelle qu’elle soit), l’individu se retrouve
au coup par coup confronté à cette simultanéité dans
la sensation. Tout l’effort d'émancipation
consistera à maintenir ce choix en suspens dans la
conduite de l’activité et jusqu’au terme de
son exercice. »
Texte intégral en suite

Sans titre, 2009. Peinture sur aluminium. 150 x
150 x 1,5 cm.

Sans titre, 2008. Peinture sur aluminium. 150 x 150
x 1,5 cm.
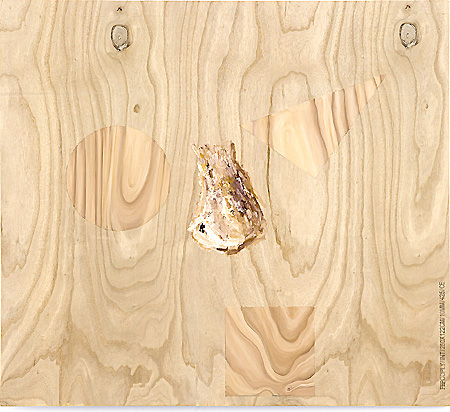
Sans titre
(Pinoccio 1), 2008. Huile sur bois. 110 x 122 x 3 cm.

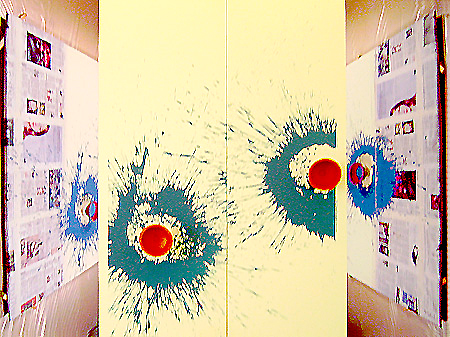
Sans
titre, 2004. Débouchoirs, tirages numériques,
peinture sur aluminium. 180 x 240 x 14 cm.


Sans
titre, 2009 (Détail). Tirage numérique et peinture
sur aluminium. 300 x 220 x 1,5 cm.

Sans
titre, 2009. Bic, crayon gris, peinture sur
aluminium. 64,5 x 74,5 x 1,5 cm.
Sans permis de conduire (introduction*)
Je ne sais pas si cette intervention traitera de l'invention.
Car de la part de quelqu'un qui n'a jamais exposé que
des tableaux dans un contexte artistique où les
possibilités techniques, théoriques et pratiques
semblent illimitées, cela pourrait paraître pour le
moins déplacé. Il faudrait alors pouvoir distinguer
l'invention de l'innovation, de la nouveauté, du
progrès historique, des redéfinitions de l'art et
autres tabula rasa téléologiques auxquelles ce
concept est trop souvent associé dans son acception
courante, pour pouvoir désigner ce dont je voudrais
parler.
A mon goût, l'invention à été trop souvent le moyen
pour son auteur, qu'il soit un individu, un groupe social
ou une génération, de redéfinir dans le cours de
l'histoire, le partage des places et des richesses à son
avantage. Ainsi qu'elle a trop servi de prétexte aux
théoriciens pour maintenir l'intelligibilité des
pratiques artistiques dans le seul cadre d'exercices
jurisprudentiels, qui chaque fois réajustent la règle
à son contexte pour mieux préserver l'ordre qui en
découle.
Cet ordre, nous pourrions dire qu'il est une certaine
stabilité de la situation de parole où nous parlons
d'art, et que cette cohérence est le résultat d'une
disposition particulière du rapport de force qu'il y a
entre les acteurs de la scène artistique. Certes, le
sujet dont je voudrais parler entretient lui aussi des
liens étroits avec la notion de pouvoir. Mais, plutôt
que de faire une invention, il s'agira de pouvoir trouver
une issue possible dans le rapport de force qui
verrouille notre présent, une manière de l'esquiver
plutôt que de le retourner en notre faveur.
Si invention il y a, elle ne peut pas provenir pour moi
d'une volonté concertée d'inventer, mais plutôt de la
façon dont on conduit une pratique artistique, une
conduite sans intérêt et sans destination qui puisse se
déduire de la situation de parole dans laquelle
l'époque traduit les œuvres : leur mode
d'identification actuel.
Lorsqu'on y prend garde, on s'aperçoit
qu’aujourd'hui, ce mode d'identification s'effectue
en nous ou malgré nous dès l'instant où l'on
considère un objet d’art. Il nous commande de
traduire l'expérience que nous en faisons avec des mots
bien définis, car ils doivent trier et rapporter deux
choses bien distinctes de la sensation qu'il nous
procurent : soit des propriétés, soit des
jugements. A savoir qu’il y aurait d'une part des
objets qui se distinguent comme étant des œuvres
d'art grâce aux propriétés spécifiques qui sont les
leurs, des propriétés qui leur appartiennent en propre
et en vertu desquelles on ne peut pas les comparer aux
autres objets. Et d’autre part, il y aurait des
objets que l’on dit être d’art, et dont le
mode d'identification est strictement relatif au jugement
du spectateur qui les regarde, ainsi qu’aux
conventions de langage par lesquelles nous décidons ce
qui est de l'art et ce qui ne l'est pas. Ce rapport de
force nous incite à discriminer dans le fouillis de
l'expérience que l’on peut en avoir, les
œuvres qui procèdent d’un mode
d’identification qui leur soit interne, de celles
qui jouent avec un mode d’identification externe,
strictement relatif aux conventions.
On reconnaît sans peine que cette séparation dans la
perception, reconduit la rhétorique stérile de
l'autonomie et du contexte, comme une vielle rengaine
dans laquelle nous continuons d'anesthésier la vivacité
du problème moderne. Peu importe ici de savoir lequel de
ces deux modes d’identifications aura raison de
l’autre, ce qui m’importe aujourd’hui,
c’est de constater à regret que cette séparation
opère toujours dans la perception que l’on a des
œuvres, et qu’elle est déterminante en retour,
pour la conception que l’on aura d’une pratique
artistique.
Une pratique, dès la modernité, ne peut pas se
comprendre comme une technique de fabrication. Si je
considère celle du tableau moderne, il ne s'agira
certainement pas de savoir faire un objet. Car ce n'est
pas simplement un objet, c'est un dispositif, un système
qui s'élabore entre 3 termes. Il y a l'objet produit (en
l'occurrence le tableau), l’institution muséale et
marchande où il s’expose et s'échange, et le
public anonyme et démocratique qui s’y rend. Dans
une pratique moderne, aucun de ces trois termes ne
pourrait être conçu sans les autres, et peindre veut y
dire pratiquer et agencer cette relation. Même si de
l'atelier ne sort qu'un tableau, sa relation à
l'exposition ainsi qu'au public auquel il s'adresse, fait
partie intégrante des matériaux avec lesquels il a
été élaboré. Du « Cabinet des abstraits »
d’El Lissitzky en passant par « Le Salon de
Madame B. » de Mondrian, sans oublier les nombreux
accrochages constructivistes, les « Merzbau »
ou les variations autour du monochrome, les exemples ne
manquent pas où le tableau se déploie comme un système
qui lie inextricablement l’objet d’art au lieu
où il s’expose, ainsi qu’il joue des
conventions par lesquelles on l’identifie comme
étant un tableau, et par là, interroge le public auquel
il se destine sur la nature du regard qu’il lui
porte.
Ce système, on peut le comprendre dans le sens où
Michel Foucault parlait de dispositif médical,
judiciaire ou carcéral. En l'occurrence, il s'agit d'un
système qui institutionnalise l'art en identifiant ce
qu'il est (ou devrait être), ainsi que dans le même
mouvement, il identifie ce que sont un artiste et le
public auquel il s'adresse. Et l'on pourrait poursuivre
la méthode de Foucault. en remontant la généalogie de
ce « dispositif art » jusqu’à la
révolution française. On en suivrait le fil dès l'extraction
des œuvres de leur niche aristocratique. On
observerait ensuite la constitution des butins de
pillages, lesquels alimentent alors un marché naissant
auprès des classes bourgeoises friandes de s'accaparer
les nouveaux signes de leur domination. Et puis,
on poursuivrait avec l’apparition de galeries
où s’exposent des dessins jusqu’à
l’ouverture des grandes galeries marchandes
parisiennes, qui partageront bien vite le public anonyme
qui s'y presse avec les Salons publics d'expositions où
se forge petit à petit, bord à bord, la forme du
tableau moderne.
Ce dispositif apparaît d'ailleurs clairement dès 1880,
moqué et tourné en dérision tous les soirs par les
Incohérents sur la scène du Chat Noir. Et sous
les griffes de la satire, c'est peut-être ici qu'il est
dévoilé et apparaît pour la première fois en tant que
tel, comme étant le matériau central des pratiques
artistiques modernes. Sur cette scène, les Incohérents
moquaient les tableaux, l'exposition d’art ainsi que
son public. Tous étaient affublés du même faux nez,
celui de l’hypocrite qui n’éprouve rien et se
comporte par convention.
Depuis, d’autres objets se sont substitués aux
tableaux à l’intérieur des espaces
d’exposition, mais les pratiques contemporaines de
l'art sont toujours aussi des pratiques de ce dispositif,
et non pas seulement de la peinture ou des nouvelles
technologies. Il s'agit encore aujourd'hui d'élaborer
des façons de le faire fonctionner ou de le faire
dérailler, peu importe que ce soit à travers la
manière dont vont y agir les objets que l'on a produit
ou bien en agissant directement sur les rapports
qu'entretiennent entre eux les différents termes qui le
composent.
A travers l'histoire de la modernité, la disposition
entre ces trois termes a connu de nombreuses
configurations. Mais il me semble que pour comprendre son
fonctionnement actuel, et revenir à la nature du rapport
de force présent et qui nous occupait tout à
l’heure, il faudrait d'abord se reporter aux années
soixante-dix et aux pratiques des artistes dits conceptuels
(ou si le mot dérange, ceux que l'on considère comme la
dernière avant-garde critique). Et en s'y reportant, il
faudrait aussi pouvoir mesurer les conséquences de ces
pratiques, à la lumière des mutations que le
capitalisme effectuait à la même époque, même si les
effets de ces transformations (ou de ces inventions
économiques) n'étaient pas encore immédiatement
perceptibles dans la société de ces années-là.
Pour résister à la rationalisation économique des
pratiques artistiques, les artistes conceptuels
ont stratégiquement supprimé un des termes du
« dispositif art ». Ils en ont soustrait
l’objet. Ou plutôt, car il faut bien des ersatz
pour que le dispositif œuvres — institutions
— public fonctionne, ils ont soustrait à
l’objet, quel qu’il soit et quelles que soient
ses qualités, la possibilité qu’il puisse avoir
des propriétés internes telles que l’on puisse y
voir une œuvre d’art. En soustrayant à
l’objet la possibilité de pouvoir réaliser, ce
qu’on peut appeler dans ce contexte d’effort
critique, une plus-value artistique par rapport aux
autres objets, les artistes ont renvoyé à de la pure
convention les modes d’identification par lesquels
on juge que tel objet est d’art ou ne l’est
pas. Rappelons que cette situation n'est pas une rupture
dans l'histoire des pratiques modernes. Nous l’avons
vu, dès les Incohérents et même plus tard Dada, les
artistes ont raillé sur scène les objets qui
prétendaient pouvoir s'extraire de la vie prosaïque des
objets marchands, renvoyant aux seuls jeux des
conventions de perception, les raisons de leur caractère
exceptionnel, et renvoyant aussi par là la question de
l'art au jeu de langage qui se noue autour de son nom.
Mais sans sous-estimer l'importance de cette généalogie
(qui connaîtra d'ailleurs bien d'autres occurrences), on
peut tout de même dire que les artistes conceptuels ont
radicalement déplacé la pratique de l’art.
D’une pratique qui élaborait une forme perceptible
visuellement, ils ont déplacé la leur vers une pratique
qui élabore le contrat de parole qui se noue entre les
différents acteurs du dispositif identifiant l’art,
lesquels acteurs doivent ainsi s’entendre entre eux
sur ce que l’on y voit, et savoir s’il
s’agit d’une œuvre et non d’une
simple marchandise.
Le conceptualisme est avant tout une pratique de ce
contrat de parole. Sa visée stratégique est de ne plus
être identifiable par l'économie, sa tactique de ne
plus produire d'objets et considérer le contrat de
parole qui tient le dispositif comme un nouvel espace
d'écriture.
Mais durant les mêmes années, l'évolution des
techniques économiques transformait sans retour les
façons de s’enrichir. La création de la plus-value
allait se déplacer elle aussi de la production
d’objets vers la production d’un contrat,
établissant les conditions dans lesquelles nous
échangerons ces objets. Ils ont pu ainsi
s’abstraire progressivement pour devenir ce que nous
en savons aujourd’hui : des marques, des logos,
des produits financiers, des contrats de service, des
expériences, etc. A ce mouvement d’abstraction qui
permet à la production de passer de l’objet au
contrat d’échange, correspond celui qui permet au
même moment à l’administration américaine de ne
plus garantir la convertibilité du dollar en or (1972,
mars 1973 avec l'adoption du « régime de changes
flottants »). Au signifiant « Un
Dollar », ne correspondra plus aucun signifié, ni
pépites en contrepartie ni même aucun éclat de la
valeur. A un dollar correspondra un autre dollar, à un
signifiant un autre signifiant. Dés lors, il deviendra
très difficile aux stratégies conceptuelles de
maintenir une tension critique efficace en gardant
l’objet produit pour cible de la domination. Car
dès que ce déplacement a eu lieu dans l’économie,
on peut faire ce que l’on veut à l’intérieur
du contrat sans y produire de transgression ni en
perturber le bon fonctionnement. Sans briser le pacte,
bien au contraire !
On peut permuter la place des différents termes,
l’art peut être ce qu’il est supposé ne pas
être, l’artiste peut devenir commissaire ou
collectionneur, le commissaire jouer le rôle de
l’artiste, l’œeuvre peut être le
commentaire ou l'espace d’exposition, le spectateur
peut finir l’œuvre et finit par la faire. On
peut faire ce que l’on veut, pourvu qu’on
continue de tourner en rond dans le contrat, lequel
garantit seul la cohérence de cette situation de parole.
Car ce régime de la parole doit reposer avant tout sur
une garantie. Dans un contexte où aucun signifiant ne
s’embarrasse plus d’un quelconque signifié, la
parole doit trouver un nouveau sol dans cet espace
« d’échange flottant ». Lorsqu’une
image s’échange sans perte avec n’importe
quelle autre image, il faut, pour pouvoir en parler, un
autre plan de consistance que ce qu’elle représente
ou ce à quoi elle se rattache. Si le contenu ne garantit
plus le bien-fondé de la parole, il faut que cette
garantie soit scellée dans le contrat qui lie les
locuteurs entre eux. Le pacte nous garantit que chaque
événement sensible perçu à l’intérieur du
cercle soit immédiatement convertible en discours ou
rapportable à un discours, lequel permettra de guider la
sensation pour identifier ce que l’on y voit. Et
l’on verra alternativement, soit des qualités
spécifiques dans des objets, soit des jeux de
tractations entre les différents acteurs du dispositif
d’identification, allant des plus autorisés
vers un public plus large qui à son tour, une fois
affranchi, réintègre le cercle du contrat duquel ils
avaient été momentanément exclus par le déplacement
d’une ou de plusieurs conventions.
C’est pour cela que l’effet transgressif est
devenu insupportable à l’âge économique où nous
sommes, et qu'on peut transgresser chaque règle sans
jamais trouver d'issues dans ce rapport de force.
En revanche, ce qui semble poser un trouble au sein de ce
pacte qui scelle la parole, ce que le contrat cherche à
esquiver, c’est qu’il puisse y avoir des
perceptions de sensations simultanées. C’est
qu’il se trouve des sensations pour lesquelles on ne
puisse pas trancher au plus tôt dans le processus de
perception, pour savoir si l’on a affaire à une
sensation relative à l’objet que l’on voit, ou
si cette sensation est l’effet d’un
déplacement, d’un écart opéré dans les
conventions de perceptions.
L’hypothèse, que je voudrais poser ici, est que
dans l’exercice d’une pratique (quelle
qu’elle soit), l’individu se retrouve au coup
par coup confronté à cette simultanéité dans la
sensation. Tout l’effort d'émancipation consistera
à maintenir ce choix en suspens dans la conduite de
l’activité et jusqu’au terme de son exercice.
* Introduction de l’intervention de
Dominique Figarella sur Le processus d'invention
lors du colloque « Experimenta 07 ».
A paraître : « Experimenta : le régime expérimental
de l'art » (E. During, L. Jeanpierre, C. Kihm, D.
Zabunyan dir.), Les Presses du Réel, automne 2009.
Publié in offshore #
20 (été 2009) © offshore
|